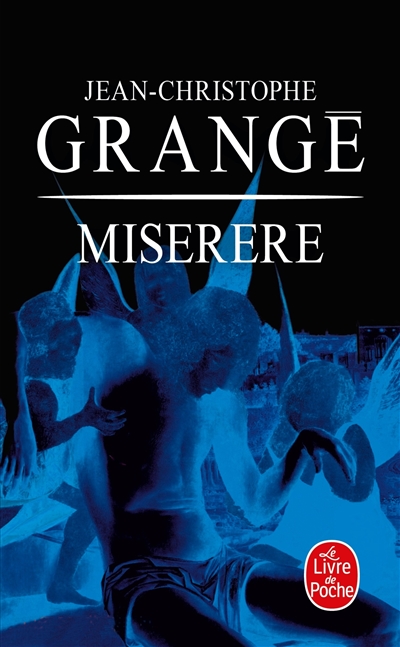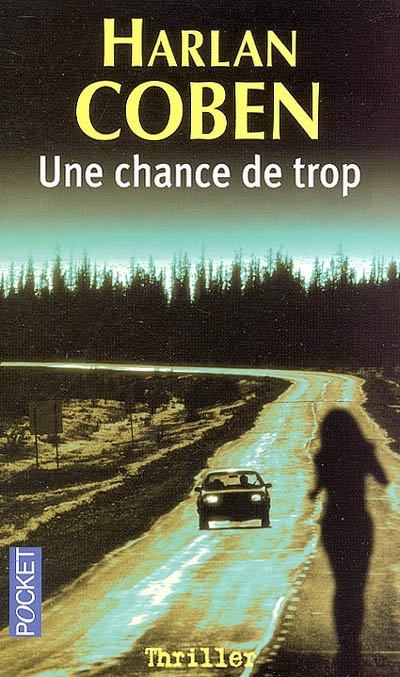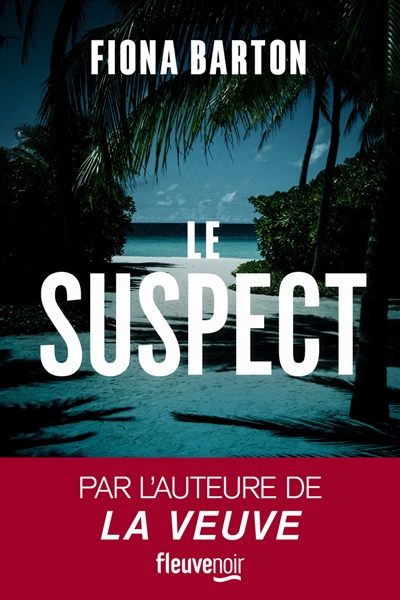2161 documents
Recherche affinée par :
Résultats de recherche
Résultats : 2101 à 2112 sur un total de 2161
Recherche fulltext pour les titres et les mots clefs :
Recherche fulltext sans les stopwords pour les résumés et les auteurs :
Miserere
Grangé, Jean-christophe
Publié en 2010
Le livre de poche
Livre
Fiction
Roman

"Ce sont des enfants. Ils ont la pureté des diamants les plus parfaits. Aucune ombre. Aucune inclusion. Aucune faille. Mais leur pureté est celle du Mal." Étrange assassinat d'un chef de chorale d'origine chilienne dans l'église arménienne de Paris. Disparitions de plusieurs enfants de chœur. Série de meurtres opérée selon un protocole macabre: perforation inexplicable des tympans, inscriptions tirées du Miserere d'Allegri, mystérieuses traces de pas autour des cadavres: pointure 36... Pour mener l'enquête, deux flics borderline comme les aime Grangé: Kasdan, le vieux briscard à la retraite, et Volo le toxico, beau comme une rock star. Origines arménienne et russe. Deux hommes intelligents, acharnés, hantés par leur passé. Du pur Grangé, complexe, tourmenté, baroque. Un de ses meilleurs thrillers, peut-être le plus inquiétant, qui mêle enfance, torture (des bourreaux nazis aux bourreaux chiliens), expérimentations scientifiques ultimes et musique...
Nationalité : France Né(e) à : Boulogne- Billancourt , le 15/07/1961 Biographie : Jean-Christophe Grangé est un journaliste, reporter international, écrivain, scénariste et scénariste de bande dessinée. Après des études de lettres à la Sorbonne aboutissant à une maîtrise sur Gustave Flaubert, il devient rédacteur publicitaire. En 1989, il se lance dans le journalisme comme grand reporter pour le National Geographic, Paris Match et le Sunday Times. Il crée par la suite la société L&G pour faire des reportages en free lance. Ces derniers vont l'entraîner aux quatre coins du monde et lui rapporter plusieurs prix : Reuter en 1991, World Press en 1992. Ces enquêtes seront aussi une formidable source d'inspiration pour ces romans. "Le Vol des cigognes", son premier roman, est publié en 1994. En parallèle de son travail littéraire, il écrit des scénarios pour le cinéma et la télévision. Son second roman paru en 1998, "Les Rivières pourpres", ne passera pas inaperçu. Le succès auprès du public se confirmera d'ailleurs en 2000, année où le roman est adapté au cinéma. En cette même année 2000 paraît "Le Concile de Pierre". En 2003, il publie "L'Empire des loups". En 2004 sort "La Ligne noire", premier tome d'une trilogie de romans sur la "compréhension du mal sous toutes ses formes." Le succès ne se dément pas avec le deuxième volet de cette trilogie, "Le Serment des Limbes" sorti en 2007. Parallèlement à sa carrière de romancier, il continue à travailler pour le cinéma : outre l'adaptation des Rivières pourpres, il a également écrit le scénario de Vidocq (de Jean-Christophe Comar dit Pitof en 2001) et a collaboré à la plupart des réalisations ou projets tirés de ses romans. Il publie "Miserere "en 2008, "La forêt des Mânes" en 2009. En 2011 sort "Le Passager" ; il travaille aussi sur le scénario et la production de "Switch" de Frédéric Schoendoerffer avec Eric Cantona et Karine Vanasse. Plusieurs de ses romans ont été adaptés au cinéma et à la télévision, il a été traduit dans une vingtaine de langue et est l'un des rares écrivains français dans son genre littéraire à être apprécié aux États-Unis.
Mots clefs :
Langue : Français
EAN : 9782253128472
L'homme qui voulait vivre sa vie
Kennedy, Douglas
Publié en 1999
Pocket
Livre
Fiction
Roman

Ben Bradford est un modèle de réussite sociale. De la pression parentale cherchant à le détourner de ses ambitions artistiques, il a fait le moteur de son ascension vers les hautes sphères de Wall Street. Ben Bradford lutte, et pourtant, il est bien obligé de se rendre à l'évidence : "réussir", "le plus américain des verbes", le fait vomir. Ce n'est pas avec fierté qu'il pose son regard sur la somme de ses possessions, mais en détaillant chaque objet par le menu, connaissant son prix au dollar près, contraint d'admettre que sa frénésie de consommation dissimule mal un terrible besoin de se sentir exister. Sa luxueuse banlieue l'oppresse et croule sous l'épaisse couche de vernis de l'american way of life qui ternit pourtant un jour à la faveur d'une sordide histoire d'adultère. Et là, Ben Bradford commet l'irréparable. S'ensuit une fuite éperdue, l'adoption forcée d'une nouvelle identité, et la révélation d'un destin qui s'épanouit malgré lui. Kennedy frappe fort et juste, à tel point qu'il instille parfois chez son lecteur une irrépressible envie de se mettre en cavale. --Lenaïc Gravis et Jocelyn Blériot 4e de couverture Un poste important, une vaste maison, une femme élégante, un bébé : pour tout le monde, Ben Bradford a réussi. Pourtant à ses yeux, rien n'est moins sûr : de son rêve d'enfant - être photographe - il ne reste plus rien. S'il possède les appareils photo les plus perfectionnés, les occasions de s'en servir sont rares. Et le sentiment d'être un imposteur dans sa propre existence est de plus en plus fort... Alors maintenant résister à l'appel d'une vie quand le destin s'en mêle ?
Nationalité : États-Unis
Né(e) à : Manhattan, New-York , le 01/01/1955
Biographie :
Douglas Kennedy étudie à la Collegiate School et au Bowdoin College dans l’État du Maine, avant de partir un an au Trinity College de Dublin en 1974. De retour à New York, il devient régisseur dans des théâtres de Broadway. En mars 1977, entre deux productions, il décide de partir à Dublin pour rendre visite à des amis.
À Dublin, il devient cofondateur d’une compagnie de théâtre. Il rejoint ensuite le National Theatre of Ireland en tant qu’administrateur de la branche expérimentale. Il y passe cinq années (1978-1983), pendant lesquelles il commence à écrire, la nuit. En 1980, il vend sa première pièce à la chaîne de radio britannique BBC Radio 4. En 1983, il démissionne de son poste au National Theatre of Ireland pour se consacrer à l’écriture. Pour survivre, il devient journaliste indépendant, notamment pour l’Irish Times où il tient une rubrique de 1984 à 1986. En mars 1988, il déménage à Londres, au moment où son premier livre, "Au-delà des pyramides" (Beyond the Pyramids), un récit de voyage, est publié.
En 1994, paraît son premier roman, "Cul-de-sac" (The Dead Heart). En 1997, il est porté à l’écran par Stephan Elliott, le réalisateur de "Priscilla, folle du désert". Son deuxième roman, "L'Homme qui voulait vivre sa vie" (The Big Picture, 1997), connaît un succès international. Traduit en seize langues, il s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires à travers le monde et a été adapté au cinéma en 2010 par Éric Lartigau avec Romain Duris, Marina Foïs et Catherine Deneuve.
Son troisième roman, "Les Désarrois de Ned Allen" (The Job, 1998) est aussi un best seller et un succès critique, traduit en quatorze langues.
En 2001, "La Poursuite du bonheur" (The Pursuit of Happiness) marque un changement radical. Après trois romans que l’on pourrait décrire comme des thrillers psychologiques, il opte pour une histoire d’amour tragique, qui reçoit un très bon accueil. Ont suivi "Rien ne va plus" (Losing It, 2002), Prix littéraire du Festival du cinéma américain de Deauville 2003, "La Femme du Ve" (The Woman in the Fifth, 2007), adapté au cinéma en 2011 par Pawel Pawlikowski, avec Kristin Scott Thomas et Ethan Hawke. Avec "La Symphonie du hasard" (The Great Wide Open), il se lance dans un ample projet: un roman fleuve couvrant une vingtaine d’années. Le premier volume est paru en 2017.
Père de deux enfants, il vit dans le Maine et à Montréal, et séjourne à Londres, Paris et Berlin.
site officiel : http://www.douglas-kennedy.com/site/accueil_site_douglas_
Mots clefs :
Langue : Français
Une chance de trop
Coben, Harlan
Publié en 2011
Livre
Fiction
Roman

La vie de Marc Seidman, chirurgien plastique dans une banlieue paisible de New York, bascule le jour où il s'écroule dans sa cuisine, touché par deux balles de revolver. Lorsqu'il se réveille douze jours plus tard à l'hôpital, il apprend que sa femme a été tuée au cours de l'agression et que Tara, sa petite fille de six mois à peine, a disparu. Une demande de rançon lui parvient bientôt. Malgré ses réticences, Marc prévient la police et réunit les fonds. Malheureusement, la confrontation échoue : les ravisseurs s'emparent des deux millions de dollars et disparaissent dans la nature. Désespéré, il se lance alors dans une lutte acharnée pour retrouver sa fille, aidé par Rachel Mills, son amour de jeunesse, ancien agent du FBI...
Mots clefs :
Langue : Français
EAN : 9782266150293
Innocent
Coben, Harlan
Publié en 2005
Livre
Fiction
Roman

Depuis que Matt a rencontré Olivia, sa vie semble prendre un tour plus heureux. Matt n’arrive pas à se pardonner l’accident terrible qui a coûté la vie à un de ses camarades de classe et dont il s’est toujours senti coupable. Mais aujourd’hui il est amoureux, sa femme attend un bébé, ils vont acheter une maison ensemble. Puis tout s’écroule : Matt reçoit sur son portable une vidéo montrant Olivia dans une chambre d’hôtel en compagnie d’un inconnu. Matt refuse de croire que sa femme puisse l’avoir trahi, mais Olivia, partie en voyage d’affaires, est injoignable. Très rapidement, autour de Matt, les gens se mettent à mourir, tandis que tout l’indique comme l’auteur des crimes…
Nationalité : États-Unis Né(e) à : Newark (New Jersey) , le 04/01/1962 Biographie : Harlan Coben est un écrivain américain de romans policiers. Il est originaire du New Jersey, où il vit avec sa femme et ses quatre enfants. Diplômé en sciences politiques du Amherst College, où il est membre de la fraternité Psi Upsilon avec l'auteur Dan Brown, il a travaillé dans une agence de voyages avant de se consacrer à l'écriture. Depuis ses débuts en 1995, la critique n'a cessé de l'acclamer. Il est notamment le premier auteur à avoir reçu le Edgar Award, le Shamus Award et le Anthony Award, les trois prix majeurs de la littérature à suspense aux États-Unis. Le premier de ses romans traduits en France, "Ne le dis à personne" (Belfond, 2002) – prix du polar des lectrices de Elle en 2003 et adapté au cinéma par Guillaume Canet en 2006 – a obtenu d'emblée un énorme succès auprès du public et de la critique. Ce succès a été confirmé par ses ouvrages suivants : "Disparu à jamais" (2003), "Une chance de trop" (2004), "Juste un regard" (2005), "Innocent" (2006), "Promets-moi" (2007) et "Dans les bois" (2008), "Sans un mot" (2009), "Sans laisser d'adresse" (2010), "Faute de preuve" (2011). Il écrit "L'imposteur" dans un recueil de nouvelles intitulé "Le jour où la mort nous sépare" paru chez Albin Michel en 2007. A noter la parution en 2010 en France de "Sans un adieu", le premier livre de Coben, près de 20 ans après avoir été écrit. En 2011 sort dans la série Myron Bolitar "Sous haute tension" puis parution en 2012 de "A découvert", qui lance la série Mickey Bolitar. En septembre 2016 est sorti aux États-Unis le roman Home, qui signe le retour de Myron Bolitar et de ses acolytes.
Mots clefs :
Langue : Français
ISBN : 2-7441-8776-3
EAN : 341154
Personnes disparues
Macdonald, Patricia
Publié en 1999
Le livre de poche
Livre
Fiction
Roman

À Taylorsville, non loin de New York, Justin. Six mois, et sa baby-sitter Rebecca, quinze ans, disparaissent. Pas de demande de rançon. Aucune trace. Les raisons de cette disparition restent inexpliquées. Fugue? Acte d'une femme en mal d'enfant'? Crime d'un pervers sexuel? Les hypothèses ne manquent pas. Les soupçons du chef de la police local se portent bientôt sur Ellen Henson. Souffrant d'une dépression due à la mort prématurée de son fils en bas âge, elle pourrait bien avoir agi sous le coup du désespoir. Quant à Doug Blake, professeur de lycée déjà jugé pour harcèlement sexuel sur la personne d'une mineure, il fait un suspect idéal. Mais est-il vraiment coupable ? Dans la petite Ville la tension monte, l'angoisse gagne du terrain, tandis que la mort qui rôde guette patiemment sa prochaine proie…
Nationalité : États-Unis
Né(e) à : Greenwich , le 01/08/1949
Biographie :
Patricia MacDonald est un auteur de romans policiers américain.
Elle a suivi des études de journalisme à Boston. Après cela, elle a collaboré à la rédaction de nombreux magazines, allant des journaux médicaux aux magazines féminins.
La voie qu'elle s'est ensuite tracée dans le roman à suspense découle sans doute de son mariage avec l'écrivain Art Bourgau, de surcroît, libraire spécialisé dans le roman noir.
Depuis 1985, date de la parution de son premier roman dans la collection «Spécial Suspense,» Un étranger dans la maison, Patricia MacDonald a vendu en France plus de 1 800 000 exemplaires de ses livres. Quatre de ses livres ont été adaptés pour la télévision.
Mots clefs :
Langue : Français
Ne tuez pas la mère porteuse !
Henry-wall, Judith
Publié en 2008
France loisirs
Livre
Fiction
Roman

Jamie croyait résoudre tous ses problèmes d'argent en acceptant de devenir mère porteuse pour une riche famille texane... Désormais, elle n'a plus qu'une issue: échapper à la horde de tueurs lachée sur elle et son futur bébé!
Nationalité : États-Unis
Né(e) à : Indiana
Biographie :
Judith Henry-Wall est née dans l'Indiana et a grandi dans une famille militaire. Elle vit à Normand, en Oklahoma, où elle a élevé ses trois enfants.
Judith Henry Wall est l’auteur d’une dizaine de bestsellers acclamés dans le monde entier.
Elle est diplômée à Gaylord College of Journalism and Mass Communication de l'Université d'Oklahoma à Norman en 1977.
Mots clefs :
Langue : Français
La femme qui en savait trop
Bale, Tom
Publié en 2010
France loisirs
Livre
Fiction
Roman

Dans le petit village où Julia vient d'arriver pour vider la maison de ses parents après leur décès, c'est le chaos. Un tireur pris de folie meurtrière est en train d'abattre tous les habitants. Résultat : 14 morts !Julia est l'une des rares survivantes. Pour la police, bien que sous le choc, l'affaire est close, l'assassin se serait suicidé.Mais Julia connaît la vérité, elle a vu le deuxième tueur. Seulement personne ne veut la croire et surtout, maintenant lui aussi sait que Julia existe...
Nationalité : Royaume-Uni Né(e) à : Sussex , 1966 Biographie : Tom Bale a travaillé comme vendeur, assureur, directeur, analyste, consultant et homme au foyer avant d'écrire à plein temps désormais. "La Femme qui en savait trop" ( Skin and Bones ) est son premier roman.
Mots clefs :
Langue : Français
EAN : 9782298019704
Faux coupable
Katzenbach, John
Publié en 2008
France loisirs
Livre
Fiction
Roman

Ashley Freeman croyait avoir affaire au garçon parfait. Idéal pour une nuit ! Mais alors qu'elle tâche vainement de s'en débarrasser, Michael O'Connell se révèle tel qu'en lui-même : excessif, agressif… dangereux. D'une manière ou d'une autre, prédit-il, ils s'aimeront pour toujours. Les e-mails d'amour fou précèdent les chantages les plus terrifiants. Et lorsque Scott, le père d'Ashley, tâche d'y mettre bon ordre, c'est à tout le clan Freeman que O'Connell déclare la guerre. Jalousie forcenée, violences sadiques… Le harceleur pousse bientôt les Freeman à rendre coup pour coup. Et ces Américains bien tranquilles, professeurs respectés, de se montrer à la hauteur du monstre… Les histoires d'amour finissent mal, en général…
Nationalité : États-Unis
Né(e) à : Princeton, New Jersey , le 23/06/1950
Biographie :
John Katzenbach est un auteur de romans policiers.
Fils de l'homme politique Nicholas Katzenbach (1922-2012), il a été chroniqueur judiciaire pour The Miami Herald et Miami News.
Son roman "Juste cause" (1992) a été adapté au cinéma en 1995 par Arne Glimcher avec Sean Connery.
"L'Analyste" (The Analyst, 2002) a remporté en 2004 le Grand prix de littérature policière.
site officiel: http://www.johnkatzenbach.com
Mots clefs :
Langue : Français
Le mystère de Noël
Higgins Clark, Mary et Carol
Publié en 2008
Le livre de poche
Livre
Fiction
Roman

160 millions de dollars! Un cadeau de Noël inespéré pour les employés du supermarché de Branscombe qui ont décroché le billet gagnant. De quoi bouleverser la vie de la petite ville et exciter la convoitise d'escrocs prêts à tout pour détrousser les gens trop crédules... Heureusement, en vacances dans ce coin pittoresque du New Hampshire, Alvirah Meehan et le détective Regan Reilly, les héroïnes préférées de Mary et Carol Higgins Clark, vont prendre l'affaire en main. Disparitions mystérieuses, suspense, humour... une délicieuse fantaisie pour passer les Fêtes avec le sourire.
Nationalité : États-Unis
Né(e) à : New-York , le 24/12/1927
Mort(e) à : Naples (Floride) , le 31/01/2020
Biographie :
Mary Theresa Eleanor Higgins connue sous le nom de Mary Higgins Clark est une écrivaine américaine.
Mary Higgins Clark est d'origine irlandaise. Orpheline de père à dix ans, elle arrête très jeune ses études pour exercer la profession de secrétaire, puis celle d'hôtesse de l'air.
Elle épouse ensuite Warren Clark, se consacre à sa famille (cinq enfants) et commence l'écriture de nouvelles. Après de nombreux refus, une première nouvelle est publiée en 1956 par un magazine. A la mort de son mari, en 1964, elle devient rédactrice de scripts pour une radio...
Parallèlement, elle continue à écrire. Son premier livre, une biographie de Georges Washington, est un échec. Elle décide alors de rédiger un roman à suspens : "La maison du guet" qui devient un best seller. En 1980, "La nuit du renard" obtient le Grand Prix du Roman Policier.
Tout en s'occupant de ses enfants, l'écrivain reprend ses études (elle obtient un doctorat de philosophie) et publie un roman par an. Aujourd'hui, elle co-écrit des livres avec sa fille, Carol Higgins Clark.
Mots clefs :
Langue : Français
Chambres noires
Giebel, Karine
Publié en 2020
Belfond
Livre
Fiction
Roman

Après D'ombre et de silence, Karine Giebel offre un nouveau recueil de textes noirs, humains, bouleversants et engagés. Il y a des soupirs, des souvenirs et des sourires. Il y a ces jours sans fin et ces nuits sans chaleur. Cette sensation d'être sale, d'être rien, moins que rien. Ces dangers qu'on n'a pas vus venir, ces risques qu'on n'a pas osé prendre. Ces tentations auxquelles on n'a pas eu la force de résister. Il y a ces mauvais héritages, ces mauvais choix, mauvaises pentes, mauvais départs. Il y a ce manque de chance. Il y a cette colère, ce dégoût. Il y a... Des fois où on préférerait être mort. Voilà ce qu'on découvre dans les Chambres noires de Karine Giebel, recueil de quatre nouvelles inédites dont les héros, ou anti-héros, incarnent et dénoncent tour à tour les manquements de notre société. Quatre histoires pour lesquelles l'auteure emprunte les titres de grands films qui l'ont marquée. Après D'ombre et de silence, elle nous offre un nouveau recueil tout en noir, humain, engagé, bouleversant, qui agit comme un révélateur, nous faisant ouvrir les yeux sur le monde en dépit de son opacité et de sa noirceur. À la fin de l'ouvrage, en bonus, trois nouvelles déjà parues dans Treize à table ! (Pocket) au profit des Restos du Cœur ainsi que Sentence, nouvelle écrite en plein confinement et publiée dans Des mots par la fenêtre (12-21) au profit de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France.
Nationalité : France
Né(e) à : La Seyne-sur-Mer , le 04/06/1971
Biographie :
Karine Giébel est une auteure de romans policiers.
Après des études de droit et l'obtention d'une licence, elle cumule de nombreux emplois dont celui de surveillante d’externat, pigiste et photographe pour un petit journal local, saisonnière pour un Parc National ou encore équipier chez McDonald.
Elle intègre ensuite l’administration. Elle est actuellement juriste dans la fonction publique territoriale et s'occupe des marchés publics au sein d'une communauté d'agglomération.
Elle publie deux premiers romans, "Terminus Elicius" (Prix Marseillais du Polar 2005) et "Meurtres pour rédemption", dans la collection "Rail noir" aux éditions La Vie du Rail en 2004 et 2006.
"Les Morsures de l’ombre", son troisième roman, a obtenu le Prix Polar du festival de Cognac en 2008 et le Prix SNCF Polar 2009.
"Juste une ombre", paru au Fleuve Noir en mars 2012, a reçu le Prix Marseillais du Polar et le Prix Polar du meilleur roman français au Festival Polar de Cognac.
"Purgatoire des innocents" (Fleuve noir, 2013) confirme son talent et la consacre définitivement "reine du polar". Après "Satan était un ange" (Fleuve noir, 2014), elle rejoint les éditions Belfond pour la parution de son 9ème roman, "De force" (2016), qui a rencontré un immense succès, de "Terminus Elicius" (2016) dans une nouvelle édition augmentée, puis de "D'ombre et de silence" (2017), un recueil de nouvelles où elle condense en quelques pages toute la force de ses romans.
Son roman "Toutes blessent la dernière tue" (Belfond, 2018) a reçu le Prix Plume d’Or du thriller francophone, le Prix Évasion, le Book d’or thriller du Prix Bookenstock 2019 et le Prix de l’Évêché 2019.
Les livres de Karine Giebel se sont vendus à plus d'un million d'exemplaires et sont traduits dans une douzaine de langues.
page Facebook : https://www.facebook.com/Karine.Giebel/
Mots clefs :
Langue : Français
Le suspect
Barton, Fiona
Publié en 2020
Livre
Fiction
Roman

Jusqu'où iriez-vous pour protéger votre famille ? Quand deux jeunes filles de dix-huit ans disparaissent lors de leur année sabbatique en Thaïlande, leurs familles se retrouvent aussitôt sous les projecteurs des médias internationaux : désespérées, paniquées et exposées jusque dans leur intimité. La journaliste Kate Waters, toujours avide d’un bon papier, se charge immédiatement de l’affaire, une occasion bienvenue pour elle de se rapprocher de son fils, parti vivre à Phuket deux ans auparavant. Mais ce qui s’apparente au départ à une simple fugue d’ados qui aurait mal tourné, s’avère rapidement être quelque chose de plus sérieux. Les découvertes alarmantes se succèdent, le nombre de suspects se multiplie et la piste criminelle ne peut plus être écartée. Face à la complexité de l’affaire et au manque de coopération des autorités sur place, Kate ne voit qu’une seule issue : se rendre sur les lieux afin de prendre l’enquête en mains. Mais cette fois elle est loin d’imaginer à quel point elle va être impliquée personnellement …
Nationalité : Royaume-Uni Né(e) à : Cambridge , 1957 Biographie : Fiona Barton est journaliste et formatrice internationale dans les médias. Elle a notamment écrit pour le Daily Mail (2005-2008), le Daily Telegraph (2002-2005) et a été rédactrice en chef du Mail on Sunday (1990-2002) où elle a d’ailleurs gagné le prix du reporter de l’année. Fiona Barton est chef de projet à Fojo Media Institute depuis 2011. Son travail de journaliste lui a permis d’observer les femmes des accusés lors des audiences et donné l’envie d’écrire "La Veuve" (The Widow, 2016), son premier roman, qui connaît un succès fulgurant dans plus de 30 pays. Elle vit avec son mari près d’Abjat-sur-Bandiat en Dordogne depuis 2013. son site : http://www.fionabartonauthor.com/ page Facebook : https://www.facebook.com/fionabartonauthor/ Twitter : https://twitter.com/figbarton
Mots clefs :
Langue : Français
EAN : 9782265114586
Un autre jour
Musso, Valentin
Publié en 2020
Livre
Fiction
Roman

Que peut-on encore perdre quand la vie vous arrache le seul être que vous avez jamais aimé ? Adam Chapman, architecte de 41 ans, a tout pour être heureux. Il vit depuis huit ans un amour sans nuages avec sa femme Claire. Mais, un matin, un coup de téléphone vient lui annoncer l’inimaginable. Alors qu’elle passait le week-end dans la maison de campagne de ses parents, Claire a été assassinée en lisière d’un bois. En quelques secondes, l’existence d’Adam vole en éclats. Mais ce qui pourrait être une fin n’est qu’un début. Car Adam n’a aucune conscience de la véritable tragédie qui a commencé à se jouer. Dès le lendemain de la mort de Claire, il va découvrir qu’il existe pire que de perdre ce que l’on a de plus cher au monde : le perdre une seconde fois…
Nationalité : France
Né(e) à : Antibes , le 19/08/1977
Biographie :
Valentin Musso est un écrivain français.
Frère de Guillaume Musso, Valentin Musso est agrégé de lettres. Il enseigne la littérature et les langues anciennes dans les Alpes-Maritimes.
Valentin Musso vit à Nice. Il a étudié au lycée Massena, est agrégé de Lettres Classiques et enseigne à Antibes.
Il baigne dans les livres depuis tout petit avec une maman bibliothécaire. Il découvre le roman noir américain quand il est adolescent. Ses goûts éclectiques le poussent aussi bien vers Stephen King que vers la littérature classique. C'est au moment de l'adolescence qu'il sent naître l'envie d'écrire. Il commence lorsqu'il est étudiant à prendre quelques notes avant de se lancer véritablement avec son premier thriller, La Ronde des Innocents. Il le soumet en 2009 sous pseudonyme aux internautes du site des Nouveaux auteurs. Le plébiscite est immédiat et unanime et, bien vite, le livre voit le jour sous la marque Les Nouveaux auteurs. En 2011, il récidive avec Les Cendres froides, un nouveau roman, toujours aux éditions des Nouveaux auteurs.
Quand Valentin Musso ne prépare pas ses cours ou qu'il n'est pas en classe, il pense à sa prochaine histoire : il prend des notes, commence ses recherches. La période des vacances d'été étant pour lui la plus propice à l'écriture : le troisième roman est déjà en préparation.
Et quand il lit, ce sont évidemment des thrillers !
Ses romans, publiés aux éditions du Seuil, ont obtenu plusieurs récompenses (prix du polar des lectrices Confidentielles, prix Sang d'encre des lycéens, prix du polar historique).
Mots clefs :
Langue : Français